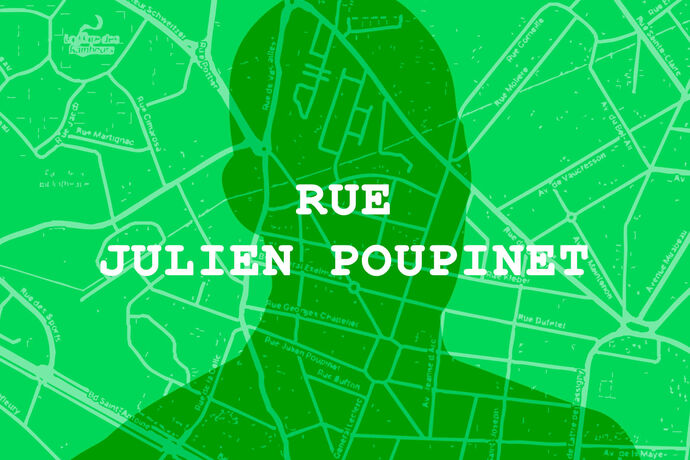La rue Julien Poupinet
Julien Poupinet, maire du Chesnay de 1913 à 1925, est une figure familière, notamment pour les habitants de Parly 2. Et pour cause : ils résident sur les terres qui lui ont autrefois appartenu. Issu d’une ancienne famille agricultrice de la commune, il est propriétaire de la ferme du Chesnay, ce qui fait de lui à l’époque le détenteur d’environ un quart du territoire actuel de la ville, essentiellement des terres agricoles.
L’entrée en politique
Une ascendance profondément chesnaysienne
Julien Poupinet, maire du Chesnay de 1913 à 1925, est une figure familière, notamment pour les habitants de Parly 2. Et pour cause : ils résident sur les terres qui lui ont autrefois appartenu. Issu d’une ancienne famille agricultrice de la commune, il est propriétaire de la ferme du Chesnay, ce qui fait de lui à l’époque le détenteur d’environ un quart du territoire actuel de la ville, essentiellement des terres agricoles.
L’entrée en politique
Julien Poupinet entre au conseil municipal en 1903, sous la protection du maire républicain de gauche Eugène Dufétel. En 1912, après les élections municipales, Dufétel se retire pour raisons d’âge et de santé, et Poupinet est élu maire. En 1920, il devient également conseiller général de Seine-et-Oise, mandat qu’il conserve jusqu’en 1928.
Une ville en pleine expansion
Son mandat coïncide avec une période de croissance démographique significative : la population du Chesnay augmente de plus de 10 %, alors que la population française globale diminue d’environ 3 %. Cette croissance est tirée par l’essor de nouveaux quartiers, notamment ceux de la rue de Versailles (côté ville), du plateau Saint Antoine et de la rue de Glatigny. Cette dynamique assure à la commune une bonne santé financière, permettant des investissements dans l’assainissement et les transports, avec par exemple la ligne de tramway Versailles–Saint Germain qui traverse Le Chesnay.
La guerre de 1914–1918 : un tournant dans son mandat
La Première Guerre Mondiale bouleverse radicalement le rôle des communes et de leurs maires. Deux conseillers municipaux du Chesnay sont mobilisés, et Julien Poupinet lui-même perd un fils au combat.
Comme tous les maires de France, il devient à la fois représentant de l’État et gestionnaire local, gérant l’aide aux blessés, aux veuves, aux orphelins et aux familles de prisonniers. Il coordonne aussi le rationnement alimentaire par tickets. Il est chargé du maintien de l’ordre public, de la recherche des déserteurs, du recensement des morts, de l’accueil des réfugiés belges et de la surveillance des citoyens d’origine étrangère.
Le 11 novembre 1918 : le retour à la paix
À l’armistice, la ville compte plus de 150 morts pour la France. Julien Poupinet pleure son fils Julien, tombé sur le front de la Somme, laissant une veuve et deux filles. Un monument aux morts est érigé grâce à une large souscription populaire. Tous les habitants y participent, quelle que soit leur condition sociale. Julien Poupinet en fait naturellement partie.
Des convictions affirmées… et contestées
Après la guerre, la politique reprend ses droits. Le Chesnay reste alors marqué à gauche, bien que cette tendance soit en déclin. Julien Poupinet, profondément anticommuniste, Républicain conservateur et chrétien affirmé, se heurte aux enseignants de la commune avec lesquels les tensions sont constantes. En 1925, contre toute attente, il est battu aux élections municipales. Trois ans plus tard, il quitte aussi le Conseil Général.
L’héritage des Poupinet
Avant de quitter la vie publique, Julien Poupinet lègue à la commune bien plus qu’un bilan de maire. Ses deux petites-filles, Madeleine et Suzanne, filles de son fils tombé à la guerre, héritent de la ferme et des terres du Chesnay. Dans les années 1960, elles vendent ces terrains à un promoteur qui y construit Parly 2. La vente est assortie d’une condition : la construction de l’église Notre-Dame de la Résurrection.
Une famille fondatrice de l’identité du Chesnay
Les Poupinet ont ainsi accompagné deux grandes étapes de l’expansion du Chesnay : l’époque agricole de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, puis l’urbanisation massive des années 1960 avec la naissance de Parly 2. Un legs historique à plus d’un titre.