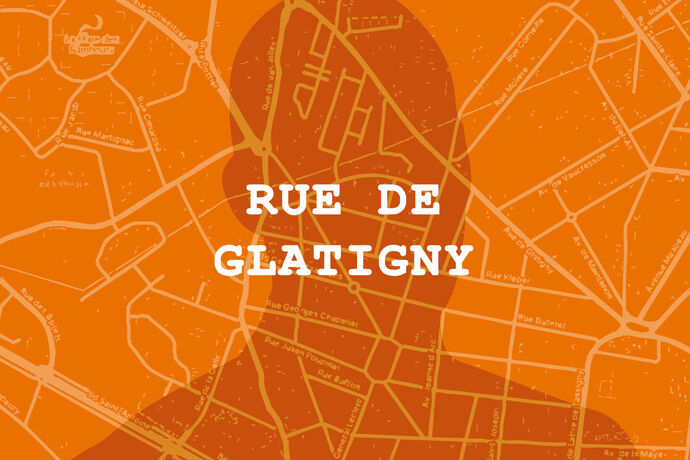La rue de Glatigny
Avec son bon kilomètre de longueur, la rue de Glatigny est la deuxième plus longue de notre ville. Elle fait référence à l’un des lieux-dits les plus anciens de la plaine de Versailles : la seigneurie de Glatigny. On retrouve sa trace dès 1209, lorsque sa dame, une certaine Pétronille de Glatigny, fait don de terres chesnaysiennes appartenant à la seigneurie à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dont relevait justement notre ville.
À la recherche d’une seigneurie disparue
Avec son bon kilomètre de longueur, la rue de Glatigny est la deuxième plus longue de notre ville. Elle fait référence à l’un des lieux-dits les plus anciens de la plaine de Versailles : la seigneurie de Glatigny. On retrouve sa trace dès 1209, lorsque sa dame, une certaine Pétronille de Glatigny, fait don de terres chesnaysiennes appartenant à la seigneurie à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dont relevait justement notre ville.
Une seigneurie convoitée par les puissants
Aux XIVème et XVème siècles, elle est la propriété d’une famille des Essarts, qui gravite autour des rois Valois, puis jusqu’en 1675, de la famille Briçonnet, également hauts dignitaires du royaume. Proche de la capitale des monarques capétiens puis valoisiens, la seigneurie attire les grands commis d’État.
Le rachat par Louis XIV et l’annexion au domaine royal
En 1675, elle est rachetée par Louis XIV, qui n’est pas encore définitivement installé au château de Versailles. La même année, il acquiert les seigneuries de Marly, de La Celle, du Chesnay et de Bougival qu’il intègre dans le domaine du parc. Celle de Glatigny est mise à disposition de Madame de Montespan, maîtresse royale, qui fait édifier par Jules Hardouin-Mansart le fastueux château de Clagny à la limite nord de l’étang, à l’endroit où se situe aujourd’hui la gare de Versailles Rive Droite. Le parc boisé de Glatigny va ainsi être annexé au parc de Clagny.
Clagny passe ensuite à l’enfant adultérin de Louis XIV et de Madame de Montespan, le duc du Maine, jusqu’à sa démolition en 1769 : coûteux d’entretien, le château gênait le développement du bourg de Versailles.
La Révolution et la dispersion progressive du domaine
Saisi par la Révolution, le manoir de Glatigny passe à la famille Gondouin, puis à celle des Fourcault de Pavant (dont un des membres sera député de Seine-et-Oise). Les terres sont quant à elles progressivement alloties pour bâtir de belles villas ou encore l’école Saint-Jean de Béthune. Le manoir devient en 1899 propriété des Petites Sœurs des Pauvres avant de disparaître définitivement.
L’étendue de la seigneurie de Glatigny
C’est une seigneurie relativement vaste. Elle s’étend de l’actuel parc Sans-Souci à la rue des Missionnaires à Versailles, et de la rue de Versailles au Chesnay jusqu’à la seigneurie de Jardies (Jardy) qui s’élève sur la colline de Saint-Cloud. Elle est constituée d’un solide manoir adossé à la colline de Saint-Cloud, disparu depuis 2005. À sa place s’élève aujourd’hui la nouvelle maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres. Tout autour s’étendent de nombreuses terres, jardins et vergers ainsi que le gigantesque étang de Clagny.
Une toponymie encore marquée par le passé rural
Les nombreux vergers et peupleraies qui recouvraient les terres chesnaysiennes sont une explication des noms arboricoles de certaines rues qui donnent sur notre rue de Glatigny : rue des Peupliers, rue des Acacias, rue de la Pépinière…
Le hameau de Glatigny et ses activités
La seigneurie avait également son hameau, vraisemblablement au niveau de la place Laboulaye, à cheval sur les communes actuelles de Versailles et du Chesnay. Elle comptait une dizaine de foyers (une petite centaine de personnes), ce qui indique une relative importance. Selon les époques, on a pu y trouver un boulanger, un cordonnier et une taverne.